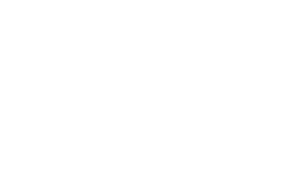Entretien avec Dr. Olivier Neyrolles, un microbiologiste et chercheur français. Ses recherches portent sur les relations hôtes-pathogènes dans la tuberculose. Il est chercheur au centre national de la recherche scientifique (CNRS) et il dirige l’IPBS-Toulouse, une unité mixte de recherche du CNRS et de l’université Toulouse-III-Paul-Sabatier. Il est récipiendaire de la médaille d’argent du CNRS (2021).
1. En tant que chercheur, pourriez-vous nous indiquer quels sont selon vous les principaux obstacles et défis à l’éradication de la tuberculose d’ici à 2030 ? Dans quelles mesures la recherche et le développement de nouvelles contre-mesures médicales permettraient des avancées en vue de cette éradication ?
Pour moi, il y a beaucoup d’obstacles, mais historiquement, c’est le manque de volonté politique, en particulier de la part des pays développés tels que les Etats-Unis et les pays de l’Union Européenne, où la tuberculose n’est plus un problème majeur de santé publique, qui est le plus significatif ; bien que l’on voit que la situation est en train de changer et que la tuberculose fait son retour du fait de la globalisation, des migrations, du changement climatique, des crises économiques, et de la paupérisation de certaines parties des pays développés.
Un marqueur de ce manque de volonté politique c’est quand même la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose en septembre 2018 : c’est la première mais c’est aussi la seule. Avant, il n’y avait jamais eu de sommet des présidents et des gouvernants sur la tuberculose. Certes, c’est très bien qu’ils se soient réunis et qu’ils aient pris des engagements, mais le fait qu’il ait fallu attendre 2018 est assez révélateur du manque de volonté politique.
Ensuite il y a des obstacles en termes d’outils pour éradiquer la maladie, notamment d’outils de diagnostic. On estime qu’on loupe peut-être 30 à 40% des tuberculoses, donc il faut des diagnostics plus fiables, plus simples et plus proches des gens. Il faut évidemment de nouveaux médicaments, et puis pour l’éradication, on n’a pas de vaccin meilleur que le BCG aujourd’hui. On peut contrôler une maladie avec des médicaments, avec des outils de diagnostic, avec une amélioration de la prise en charge des patients, etc., mais pour éradiquer une maladie infectieuse telle que la tuberculose, un vaccin efficace est essentiel. Il existe plusieurs axes de recherche aujourd’hui, qui sont tous aussi importants les uns que les autres : la recherche de nouveaux outils de diagnostic et thérapeutiques et notamment les thérapies alternatives. Mais pour l’éradication, il nous faut un nouveau vaccin plus efficace que le BCG, ou que l’on puisse utiliser en complément du BCG.
2. Pourquoi est-il important d’investir maintenant dans la recherche et développement contre la tuberculose ? Est-ce que vous voyez des progrès encourageants concernant des tests, des traitements ou des vaccins nouveaux ou prometteurs ? Comment ces futurs outils pourraient venir concrètement soutenir la lutte contre la tuberculose ?
Il faut investir maintenant parce que nous n’avons pas suffisamment investi avant ! Il faut vraiment se dépêcher d’investir parce que les projections de 2015 à 2030, c’est une trentaine de millions de décès, avec des coûts économiques qui sont de 1000 milliards de dollars au niveau mondial. Il s’agit non seulement des coûts des traitements, mais également des pertes économiques dues au fait que les gens ne travaillent plus. Il y a des pays en Afrique et en Asie où le coût de la tuberculose c’est 1 à 2% du PIB, ce sont des impacts économiques considérables. Il faut investir maintenant plus que jamais.
Il y en a énormément de progrès sur les tests de diagnostic avec des tests beaucoup plus simples, fiables et moins invasifs que les tests actuels (examen des crachats au microscope, test moléculaire basé sur la PCR, examen radiographique des poumons, test basé sur les fluides corporels, etc.). Une de nos équipes au laboratoire travaille sur des tests basés sur l’air que l’on exhale. C’est un peu comme un alcootest, où l’on soufflerait dans un tube et selon le changement de couleur, on aurait un diagnostic fiable. Un de mes collègues et son équipe sont en train de l’implémenter et de le tester dans des pays où il y a un fort taux d’incidence. Les premiers résultats sont extrêmement encourageants avec une fiabilité très forte.
Il y a aussi de nouveaux médicaments qui sont développés, avec de nouvelles molécules qui ont été mises sur le marché récemment. Le problème c’est que lorsqu’on met un nouvel antibiotique sur le marché, il y a des résistances qui se développent dans la foulée. Il y a aussi de nouveaux protocoles de soins, qui ne sont pas encore approuvés par l’OMS, mais qui permettraient d’aller vers des protocoles de traitement plus courts. La tuberculose la plus simple à traiter nécessite 6 mois de traitement, dont 2 mois de phase d’attaque et 4 mois de consolidation, c’est très contraignant. Avec ces nouveaux protocoles, on aurait peut-être une durée de traitement de 4 mois ou moins, ce qui serait une avancée significative.
Et puis on a des candidats vaccins qui sont en essai de phase 3 chez l’homme, et qui sont pour certains très prometteurs. Il y a un vaccin développé par GSK et Gates qui a montré une efficacité de 50% quand il est donné en plus du BCG. Il y a des aussi des vaccins vivants qui sont testés actuellement en phase 3 et qui ont donné des très bons résultats chez l’animal en préclinique et en phases 1 et 2.
3. Actuellement, quels sont les principaux freins à la recherche et au développement de nouveaux outils ? Après avoir assisté à la découverte très rapide de diagnostics, traitements et vaccins contre le Covid-19, quels sont, selon vous, les principaux obstacles au fait de répliquer un tel succès mais contre la TB ?
Comme décrit dans la question précédente, il y a vraiment des raisons d’être optimistes, mais les investissements sont encore trop faibles. Quand on compare avec la COVID, en 2 ans, c’est 10 milliards de dollars investis en recherche sur le vaccin. La tuberculose en 2019, sur une année, c’est 100 millions, c’est à dire 100 fois moins. Quand la COVID est arrivée, les pays développés ont été fortement touchés, il y a une panique générale, on a déclaré une pandémie, et là il y a eu de l’argent. La tuberculose, on ne sait pas très bien où est l’argent. Dans les faites, il faudrait beaucoup plus d’argent, pas seulement sur la recherche, mais aussi sur l’implémentation et sur l’accès aux soins par certaines populations qui ont des accès aux soins difficiles. On a bien vu avec la COVID, qui a complètement perturbé les systèmes de santé, que dans les pays peu armés, les patients tuberculeux sont complètement passés à la trappe. Cela étant, il ne faut pas non plus laisser penser que si on investissait autant qu’on a investi sur la COVID, on trouverait en 2 ans ce qu’on n’a pas pu trouver en 100 ans.
En plus des freins financiers évidents, nous avons aussi des freins en termes de connaissances concernant la nature de la maladie. La COVID est une maladie qui est, dirons-nous, « simple » : c’est à dire que c’est un peu comme la grippe, si on développe des anticorps contre cette maladie, on est protégé. Quand on est infecté une fois, l’on est plus ou moins protégé contre une infection ultérieure, si on laisse de côté la question des variants. Donc, pour simplifier, on fait un vaccin contre l’antigène identifié, qui permet de produire des anticorps et l’on est protégé.
La tuberculose, c’est complètement différent : ce n’est pas parce qu’on est infecté une fois qu’on ne peut pas être réinfecté. Deuxièmement, la protection par anticorps n’est pas du tout le mode de protection principal contre la tuberculose. Dans ce cas, l’immunité est beaucoup plus compliquée, elle est basée sur les cellules et les lymphocytes, c’est ce qu’on appelle une immunité cellulaire. De ce point de vue, la tuberculose ressemble au Sida, c’est d’ailleurs pour ça que pour le Sida, l’on n’arrive pas à trouver un vaccin. On ne sait pas très bien développer un vaccin qui stimule des immunités cellulaires parce qu’on ne sait pas quelle immunité cellulaire stimuler. Actuellement il y a tout un champ de recherche pour essayer d’identifier au niveau des lésions dans les tissus quelles sont les populations de cellules immunitaires qui protègent. On est vraiment au balbutiement de la compréhension de l’immunité protectrice contre la tuberculose et ça, ce sont des approches qui coûtent extrêmement cher.
Aujourd’hui, ce qui est encourageant, c’est que nous avons des vaccins dans toutes les phases cliniques, on a des vaccins candidats en phase préclinique, on commence à comprendre l’immunité qui protège contre la tuberculose, et avec cette connaissance, on va pouvoir développer de nouveaux vaccins. Mais tout ce travail est long et incertain : il ne faut pas que ce continuum s’assèche. Au contraire, il faut amplifier ce mouvement avec de la volonté politique et des niveaux de financement appropriés.
Enfin, un dernier aspect qui est, selon moi, important de mentionner : il faut insister sur la recherche fondamentale et sur son financement. Malgré des évolutions récentes positives, il reste une différence très importante entre les Etats-Unis et l’Europe à ce sujet. Par exemple, dans le dernier appel Horizon Europe il y a eu quelques lignes sur la recherche fondamentale, mais ça reste encore trop peu. En comparaison, les Américains ont des dizaines de millions de dollars pour faire de l’immunologie, c’est-à-dire pour « essayer de comprendre ». Notamment, grâce à la recherche fondamentale, les Américains viennent d’identifier des sous-sous-populations de cellules immunitaires, dont on n’aurait jamais pu soupçonner l’existence il y a 2 ans, et qui sont probablement cruciales pour protéger contre la tuberculose, en tout cas chez les primates. Les Européens n’auraient jamais pu une telle découverte avec les moyens dont ils disposent actuellement.