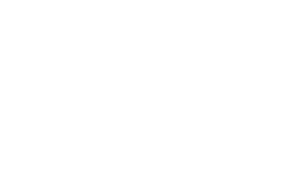Entretien avec Simon Kaboré, directeur exécutif du Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) basé au Burkina Faso
1. La lutte contre le VIH/Sida a été un tournant pour la santé mondiale. Selon vous, avons-nous capitalisé sur les leçons apprises de la lutte contre le sida pour répondre à la crise actuelle ?
Malheureusement nous n’avons pas su capitaliser les leçons apprises de la riposte contre le VIH/Sida. Dans plusieurs de nos pays africains, les ripostes contre le Covid-19 ont été élaborées sans les communautés. Non seulement, ces dernières n’ont pas participé à l’élaboration des plans de riposte nationaux, mais ces plans ne prévoyaient pas d’interventions communautaires, ce qui a été une très grosse erreur. La Déclaration d’Alma Ata de 1978 admet l’implication des communautés dans les systèmes de santé, de même avec l’initiative de Bamako instauré dans les années 1990. Bien qu’identifié, l’implication réelle des communautés traine à être mis en œuvre convenablement. C’est quand le VIH est apparu qu’il nous a été imposé de mettre tout ça en pratique. Malgré cette période, puis celle de la tuberculose et des autres pandémies, il a encore fallu faire de la pédagogie pendant le Covid19. Au lieu d’être directement opérationnel, nous avons encore perdu du temps à expliquer et justifier pourquoi le travail doit être fait avec la société civile et les communautés. Avec RAME, nous avons dû faire du plaidoyer afin de pouvoir impliquer les communautés. Pour cela, nous avons élaboré en urgence un guide sur les ripostes communautaires en matière de lutte contre le Covid-19, afin de pouvoir orienter les responsables politiques qui ne savaient pas ce qu’ils pouvaient demander aux communautés. Nous avons perdu énormément de temps à discuter de la pertinence d’impliquer les communautés alors que cette évidence existe depuis déjà très longtemps. Cela fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de société civile dans la santé et à chaque nouvelle occasion c’est la même chose. Nous consommons bien trop d’énergie à convaincre les mêmes personnes de la légitimité et de la nécessité de notre existence.
2. Pourquoi pensez—vous qu’il faille toujours justifier le fait d’impliquer les communautés ? Pourquoi les responsables politiques ne prennent pas ça en compte ?
Selon moi, il y a trois raisons majeures. Tout d’abord, c’est une question de conflit d’intérêt. Beaucoup de ressources financières proviennent de l’aide publique au développement (APD) ; donc impliquer la société civile voudrait dire de partager ce budget. Le but étant de réduire le nombre de bénéficiaires, exclure la société civile est ce qu’il y a de plus simple.
Ensuite, il y a la formation des médecins, qui sont ceux qui dirigent principalement les systèmes de santé, car ils n’acceptent pas qu’un autre corps exerce ces responsabilités. L’approche communautaire qui intègre les associations dans une vision de démocratie sanitaire n’est pas enseignée dans la formation des médecins. La version de la santé communauté enseignée dans le curriculum des médecins est uniquement par la gestion des relais communautaires, avec les comités de gestion communautaire. De ce fait, quand ces personnes à responsabilités arrivent sur le terrain, ils cherchent seulement à voir les comités de gestion des centres de santé périphériques et les relais communautaires. À la place, ils devraient élaborer des politiques et gérer les ressources avec la société civile, qui est elle-même organisée non seulement au niveau des villages mais également dans les centres médicaux, dans les hôpitaux, et qui sont entièrement capables de gérer de grosses sommes d’argents. Malheureusement, ce n’est pas la vision de ces médecins dans les postes de responsabilité, ils ne savent pas composer avec cette idée car ils n’ont pas cet esprit de démocratie sanitaire.
Enfin, les instances internationales comme l’OMS ou l’UNICEF, qui appuient nos pays dans le secteur de la santé, n’ont pas la bonne approche non plus. UNICEF par exemple, ne prend pratiquement jamais en compte la société civile dans ses interventions concernant la santé communautaire. Heureusement on note des évolutions positives de cette position dans certains pays, notamment au Burkina Faso. Pour l’OMS, la santé communautaire se résume à des comités de gestion et des agents de santé communautaires. Dans nos pays, les ministères se tournent vers l’OMS en termes d’approche de santé, donc il est évident qu’ils soient conseillés dans cette logique de marginalisation de la société civile. Le changement doit partir du niveau de l’OMS et de l’UNICEF : il est impératif qu’ils revoient leur concept de la santé communautaire et qu’ils comprennent que les associations ne se résument pas aux prestations sur le terrain avec des relais communautaires mais qu’ils interviennent dans la gouvernance du système depuis le niveau central et dans le suivi de la transparence.
3. Quelle observation tirez-vous de la réponse mondiale contre le covid19 ? Est-elle adaptée aux besoins des populations en Afrique ? Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment ?
Il n’y a pas eu de réponse africaine à la pandémie Covid-19. Je n’ai pas l’impression que les pays africains se soient sérieusement demandés quelle serait l’approche adaptée pour le continent. À la place, les pays ont tout simplement suivi ce qui a été décidé au niveau international. Pourtant, la pandémie n’avait pas la même configuration, mais nous avons quand même adopté les mêmes mesures qu’en Europe. Je prends le cas des mesures nationales prises dans les pays francophones. Les présidents ont tous pris la parole après la première allocution d’Emmanuel Macron sur le Covid-19, qu’ils ont arrangé pour leur propre pays. C’est comme-ci Emmanuel Macron avait tracé les lignes directrices des initiatives présidentielles en matière de lutte contre le Covid-19 en Afrique. Encore aujourd’hui, certains pays africains ont encore un couvre-feu alors que les cas sont au plus bas. J’observe un décalage clair entre les mesures prises et la réalité en Afrique. C’est d’ailleurs pendant la crise sanitaire que nous avons réalisé que nos dirigeants ne prenaient pas de décisions propres à eux-mêmes, qu’ils n’avaient pas analyser la situation de manière à initier leurs propres politiques. Au contraire, ils sont là pour recevoir « la dictature scientifique » du monde et à la répercuter sur leur population. À titre d’exemple, un responsable politique m’a confié que s’il y avait toujours un couvre-feu dans son pays, c’est parce que c’était une demande de ses partenaires financiers. Ces derniers évaluent la situation en fonction de leur propre pays, peu importe le contexte local et si les populations locales sont d’accord. De ce fait, si le couvre-feu est levé, les partenaires risquent d’arrêter les financements. Il est donc difficile pour nos autorités de réfléchir selon les déterminants de l’épidémie dans leur pays. Il est plus facile d’aller dans le sens de la « dictature de la santé mondiale. »
À l’échelle du Burkina Faso, une initiative de la société civile aurait pu être portée par les pouvoirs publics : le mouvement COMVID COVID19 « Les Communautés s’engagent à vider le COVID19». Un appel citoyen a été lancé par la Plateforme Démocratie Sanitaire et Implication Citoyenne afin de constituer des cellules citoyennes de veuille sanitaire dans les quartiers de Ouagadougou, dans un premier temps puis dans d’autres villes. Cela a commencé par de la sensibilisation, puis les organisations se sont organisées pour produire du savon, des masques ou encore du gel. Tout cela au niveau des quartiers, sans pratiquement aucun financement et en créant de l’emploi. C’est exactement cela que les pouvoirs publics auraient dû faire, au lieu de rester dans la logique d’élaboration de plan financé par les partenaires. Le Covid-19 à un côté positif dans le sens où il a attiré l’attention sur l’importance de la santé. En Afrique, les gens négligent l’aspect santé et ne vont à l’hôpital que quand ils et elles sont gravement malades. Les bilans de santé sont vus comme une perte d’argent. Toutefois, le Covid-19 a été pour nous, une opportunité d’ancrer la question de la santé dans les communautés. Cela a été également l’occasion d’introduire le concept de souveraineté sanitaire auprès des communautés. En effet, le Covid-19 nous a montré que l’Afrique doit revoir sa souveraineté. Par exemple en matière de produits de santé, nous avons vu que l’Inde, appelée « Pharmacie des pays pauvres » a abandonné ces derniers pour se concentrer sur sa propre population. Ce qui est logique. L’Afrique doit alors développer ses propres capacités de production de produits de santé pour être plus souveraine. Je n’ai toutefois pas l’impression que cela a été compris par nos dirigeants. On attendra donc la prochaine crise pour subir les mêmes contraintes et les mêmes dommages, si non plus.
4 .Comment éviter de reproduire les mêmes erreurs ? Quelles leçons devons-nous retenir de la pandémie actuelle pour les prochaines pandémies ?
Il y a deux éléments principaux : renforcer la résilience des communautés et renforcer les systèmes de santé. Tout d’abord, il faut renforcer la conscience citoyenne en matière de santé et leur faire confiance afin qu’ils prennent eux-mêmes en charge leur propre santé. Ensuite, les dirigeants doivent renforcer la résilience globale de l’Afrique en matière de recherche et de production de médicaments. Encore aujourd’hui, nous sommes incapables d’expliquer pourquoi la pandémie à moins impacter l’Afrique que d’autres endroits du monde. Si nous avions eu nos propres centres de recherche, nous aurions pu faire des propositions, qui d’ailleurs aurait pu être décisives dans la lutte contre le Covid-19 au niveau mondial. Par ailleurs, nous nous rendons bien compte que tous les produits de santé viennent d’Europe donc en temps de crise et d’urgence, nous nous retrouvons sans rien. Nous devons donc renforcer la résilience de l’Afrique en recherche en matière de santé mais également renforcer la résilience de l’Afrique en matière de production de médicaments et matériel médical.
5. Quelle est votre analyse sur la création de l’agence africaine pour le médicament ? permettra-t-elle de répondre aux enjeux d’accès aux médicaments dans les pays africains ? En quoi cette agence permettra-t-elle d’améliorer l’accès aux médicaments dans les pays africains ?
Cette agence peut réellement être bénéfique pour l’Afrique si elle aide le continent à avoir une plus grande souveraineté régionale. Pour cela, il faudrait qu’elle propulse l’émergence d’un secteur pharmaceutique solide. Aujourd’hui, il y a des pays africains qui mettent en place des initiatives de production de médicaments. Toutefois, celles-ci sont isolées et sans un marché sous régional du médicament. Elles ne peuvent donc pas bénéficier d’une économie d’échelle suffisante pour avoir des prix suffisamment bas pour concurrencer avec les industries indiennes, chinoises, européennes, …L’agence doit pouvoir aider à créer un marché régional et un système d’assurance qualité. Cependant, il ne faudrait pas que cette agence vienne renforcer les systèmes de protection des brevets. Souvent, l’émergence de structures régionales de ce type, est l’occasion pour les financeurs de faire appliquer les APDIC + et c’est exactement ce qu’il faut éviter : un durcissement des systèmes de protection des brevets au niveau de l’Afrique. L’agence africaine pour le médicament ne doit pas être une structure satellite des firmes internationales qui viennent encore nous compliquer la vie. La société civile africaine n’est pas très mobilisée à ce niveau de discussion, donc ça peut être dangereux pour le futur de cette agence.